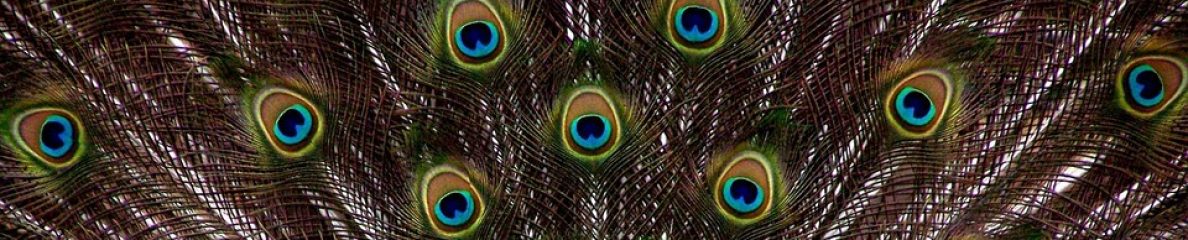« L’Antananarivo que j’ai connu dans ma jeunesse n’a rien à voir avec celui d’aujourd’hui, et pourtant, à bien des égards, il n’a pas changé. Je suis née dans une famille extrêmement conservatrice. La branche paternelle sort tout droit de la cour de l’Imerina, vieille famille aristocratique, protestante, policée, inaccessible. Du côté de ma mère, c’est toujours cette droite merina, mais sensiblement assouplie par la décadence financière : avoir connu la misère vous oblige à ravoir les pieds sur terre.
J’ai été élevée par mes grands-parents paternels. Un choix qui n’est pas le mien, mais pour lequel je reste reconnaissante. J’ai eu l’enfance la plus belle, la jeunesse la plus joyeuse et ne me souviens d’avoir manqué de rien. Mais quand vous êtes l’enfant de l’Imerina (*), votre destinée est tracée avant même vos premiers pas. Quelle sera votre éducation, quelle sera votre religion, qui seront vos amis, de quelle famille viendra votre époux – car le mariage est obligatoire : c’est votre lignée, votre ascendance et votre sang qui les déterminent. Et vous n’avez rien à dire, rien à faire, sauf obéir. L’obéissance est la base de l’éducation d’une fille de la haute aristocratie merina.

Je n’ai pas fait de grandes études, ce n’était pas le but qu’on avait choisi pour mon existence. J’aurais aimé être une grande pianiste ou une poétesse, mais c’étaient des activités considérées comme divertissantes plutôt que professionnelles. Mes fréquentations étaient limitées aux enfants des amis de la famille, à ceux des collègues de mon père ou à mes cousins et cousines. Rien ne présageait que je rencontrais ce jeune homme, mais je l’avais rencontré. Nous sommes au début des années 1960, et la ferveur de la jeune République n’était pas encore tombée. Il y avait souvent des fêtes, parfois organisées, parfois spontanées, et on se retrouvait dans l’une ou dans l’autre, entraînés par des amis, des amis d’amis. C’était grisant. L’époque était grisante. Et pour la première fois, mes parents avaient lâché du lest. Je pouvais explorer un peu la ville, si j’étais accompagnée, si je rentrais à l’heure et ne manquais pas à mes devoirs de bonne chrétienne.
La fête était donnée par notre église. Il y avait des garçons : une population qui, à ce jour, se limitait pour moi à mon père, mes oncles, mes frères et mes cousins. Autrement dit : la famille. A cette fête, il y avait ce garçon, 17 ans, qui accompagnait ses parents. J’avais 16 ans, avec toute la volubilité de mon jeune âge et la curiosité de l’adolescence. Nous avions fait connaissance, nous nous étions appréciés et nous nous étions fréquentés. En cachette, bien évidemment. Ce n’était pas nos âges qui étaient problématiques, car à mon époque, 16 ans était déjà un âge pour fréquenter un futur époux.
Le problème était tout autre. Je suis une enfant de l’Imerina, une de ces petites filles modèles, et nous n’étions pas faites pour sortir des sentiers battus. Pourtant, mon amoureux marchait en dehors des sentiers battus, le garçon qui sifflait derrière la barrière. Un père Hova, et une mère aux origines « inconnues » (1): il était la roture et la populace, j’étais la crème et la grâce. Rien, dans l’imaginaire merina, ne permet cette union : les princesses n’épousent pas les servants. Et même si l’esclavage (2) était aboli, dans l’inconscience – ou la conscience des gens – perdure ce clivage entre les deux faces d’un même peuple. Et nous nous trouvions au milieu de cette frontière brûlante, jeunes et épris l’un de l’autre.
J’étais tombée enceinte. Il y a une foule de « si » et de « j’aurais du » dans la vie des êtres humains, et on les paie toujours au prix fort. Quand l’enfant de l’Imerina humilie les siens, c’est la curée. S’éprendre de l’interdit, était déjà l’insulte en soi, selon mes parents. Mais « concrétiser » cet amour interdit était l’affront ultime. Qu’est-ce que je risquais ? La honte, bien évidemment. Ma répudiation par mes parents qui n’auraient jamais accepté un gendre de la classe d’en bas. Et la répudiation de mes parents par mes grands-parents qui n’auraient jamais toléré qu’une jeune fille mette à mal toute une lignée, par une mésalliance (3). C’est compliqué à expliquer, et peut-être même irrationnel. Mais dans l’esprit de la gamine que j’étais, j’étais responsable du déclin (4) de ma famille. J’étais l’ennemi qui allait faire écrouler la couronne. J’étais le paria.

Mes grands-parents paternels, mes parents et ma tante – sœur aînée de mon père – avaient vite fait de prendre la décision qui s’était imposée. La dame s’appelait Ravônina – Yvonne, je présume. Je ne sais comment cette dame a été trouvée, mais au surlendemain des violentes représailles familiales, elle était là, dans ma chambre. Ma grand-mère, ma mère et ma tante assistaient à l’opération, chacune sur un fauteuil. Et moi, allongée à même le parquet, sur une natte propre. Ravônina remontait mes jupons et faisait ce pour quoi elle avait été convoquée. La faiseuse d’ange utilisait une aiguille à tricoter pour transpercer la poche des eaux et ouvrir le col de mon utérus. La dilatation et le curetage forcés sont la douleur extrême que j’ai jamais connue, physiquement et psychologiquement. Il y avait du sang et de la peine.
J’étais à nouveau cette fille obéissante que j’ai toujours été. Déjà rabrouée par les menaces et les intimidations de ma famille, je n’avais pas même osé lâcher un cri de douleur. Juste des larmes silencieuses, tandis que je saignais. Personne ne pipait mot, personne n’était venue me sauver : je devais avorter ma honte, payer ma faute et faire profil bas.

Je saignais des jours. J’étais alitée des jours. Enfermée à la maison des semaines, des mois, loin de la vue d’Antananarivo. Personne jamais n’était revenu sur ce drame : j’avais compris la leçon. Un an plus tard, l’année de mes 17 ans, on me présenta mon futur mari que j’épousais l’année suivante. Il était de notre rang, convenait à notre statut et n’avait aucun cadavre dans ses armoires. Nous avons six enfants : trois fils, trois filles. Je n’ai plus cherché à revoir mon amour de jeunesse : lui et sa famille s’étaient totalement volatilisés de notre église. Ce n’est que plus tard, des années plus tard, que j’ai su que mes grands-parents avaient pesé de tout leur poids pour les chasser.
Mais pour vous dire à quel point l’emprise du rang est impressionnante, à aucun moment après cette tragédie, je n’avais ressenti autre chose que de la honte. La honte d’être moi, la honte d’être une déception et la honte d’avoir osé bafouer la couronne, alors même qu’elle n’était plus. Et à aucun moment, il ne m’était venu l’idée que je pouvais choisir d’aimer qui je voulais, ni que mon corps et mon ventre pouvaient être miens. J’étais la fille de l’Imerina et j’obéissais. »
Mialy, 73 ans, Antananarivo, janvier 2021.
(1) : l’expression utilisée est « tsy fanta-pototra »
(2) : Mialy présume que la mère de son amoureux était issue d’une famille asservie.
(3) : l’expression utilisée est « mandrorona ».
(4) : l’expression utilisée est « mikorosofahana »
(*) : l’expression utilisée est « taranak’Imerina »
Note : Ce texte fait partie d’une série qui compte plusieurs témoignages de femmes qui ont avorté, qui ont pratiqué l’avortement en tant que professionnel dans le corps médical ou qui ont décidé de poursuivre leurs grossesses. Elles porteront toutes mon nom (Mialy) dans cette série, en signe de ma solidarité envers elles, envers toutes, qu’elles soient pro-choix ou pro-vie.
L’interruption volontaire de la grossesse, y compris l’ interruption de grossesse pour motif médical, est interdite par la loi malgache.